1.1 - Définition
Tout milieu aquatique est
fondamentalement un écosystème; c'est-à-dire un système unitaire et
fonctionnel incluant une communauté d'organismes vivants (la
biocénose) et leur environnement (le biotope).
1.2 - Le biotope
Le biotope est constitué par l'eau et
le substrat (lit et berges des écosystèmes d'eau courante, cuvettes
des écosystèmes d'eau stagnante). Il dépend de facteurs climatiques,
géologiques et topographiques ayant trait au bassin versant.
Il peut être caractérisé par un certain
nombre de composantes qui interagissent de façon complexe rendant
délicate l'analyse de l'état global d'un milieu en constante
évolution : variation des débits, concentration en éléments
chimiques,...
1.3 - Les biocénoses
A quelques rares exceptions, l'ensemble
des grands groupes végétaux et animaux est susceptible d'être
rencontré dans les eaux douces (virus, bactéries, algues, végétaux
supérieurs, protozoaires, invertébrés et vertébrés). Ces organismes
peuvent être regroupés en grands communautés : planctonique (1),
périphytique (2), benthique (3), ...
Les organismes ont, entre eux, des
relations intra ou interspécifiques, de nature trophique (relation
proie/prédateur), parasitaire (relation hôte/parasite) ...
1.4 - L'habitat
Les différents facteurs de l'écosystème
aquatique peuvent être rassemblés en trois catégories :
- les facteurs
physico-chimiques (pH, sels dissous,...), qui, dans leur ensemble,
peuvent être considérés comme relativement stables à une grande
échelle spatiale (tronçon de cours d'eau);
- les facteurs morphodynamiques
(granulométrie, vitesse du courant, hauteur d'eau,...) susceptibles
de variations importantes à des échelles beaucoup plus petites et
qui de ce fait vont contribuer à répartir, en fonction de leurs
exigences écologiques, les organismes dans les milieux aquatiques;
- les
facteurs biotiques ou ensemble des relations intra et
interspécifiques.
L'interdépendance de tous ces facteurs
et leurs variabilités spatiales et temporelles font du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques un équilibre dynamique en
perpétuel ajustement.
Dans un contexte physico-chimique
donné, les facteurs morphodynamiques mesurés à l'échelle des
différents organismes vont déterminer, pour chacun d'entre eux, le
cadre, essentiellement physique, l'habitat, dans lequel chaque
individu va accomplir les fonctions biologiques permettant le
maintien des populations.
La juxtaposition des différents
habitats dont les limites sont susceptibles de variations dans le
temps, conduit à une structure habitationnelle du type "mosaïque"
dont la complexité apparaît, en l'absence de toute perturbation de
nature physico-chimique, garante d'une biodiversité élevée.
Le rôle central que joue l'habitat fait
que tous travaux (curage, endiguement, rescindement,
reprofilage,...) en perturbant les équilibres morphodynamiques,
affaibliront les capacités du milieu à héberger, protéger et assurer
le déroulement normal du cycle de développement des différents
organismes.
1.5 - L'édifice trophique
Les relations inter organismes
s'expriment entre autres, à travers la nécessité pour chacun de se
nourrir.
L'organisation de l'écosystème en
réseau trophique apparaît donc fondamentale et conduit au recyclage
permanent de la matière organique et minérale.
Le recyclage passe par deux étapes
essentielles : l'assimilation par les organismes et la décomposition
de ces organismes après leur mort.
Les végétaux aquatiques chlorophylliens
ont la propriété de synthétiser leur propre matière organique
carbonée à partir du gaz carbonique dissous dans l'eau. Cette
réaction nécessite une source d'énergie externe apportée par le
rayonnement solaire et aboutit à la synthèse de molécules complexes
(glucides, protides, lipides,...)
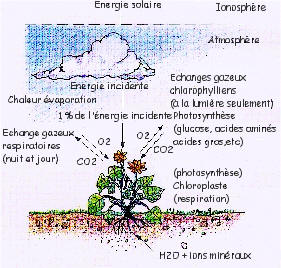
Schéma de la photosynthèse d'après
FRIEDEL H. [40]
Photosynthèse :
l'extraordinaire usine que constitue une plante, capable de
convertir les éléments minéraux puisés dans le sol et dans l'eau en
tissus organiques, a pour source d'énergie le Soleil et, pour
"ateliers", les cellules chlorophylliennes qui peuvent être
considérées comme les meilleurs capteurs solaires existant
actuellement
Les plantes vertes se nourrissent
d'aliments minéraux qu'elles puisent dans l'air ou dans l'eau (CO2)
La réaction globale qui nécessite la
présence de lumière et de pigments dans les cellules végétales peut
s'écrire :
| 6 CO2 |
+ |
12 H2O |
pigment
chlorophyllien |
C6H12O6 |
+ |
6 O2 |
+ |
6 H2O |
| |
|
|
------------> |
|
|
|
|
|
Gaz
carbonique |
|
eau |
énergie |
glucides |
|
oxygène |
|
eau |
Ces végétaux, autotrophes pour le
carbone, puisent dans le sol ou dans l'eau les autres éléments
nutritifs (azote, phosphore,...) indispensables à leur
développement.
Ils constituent le premier niveau du
réseau trophique, celui des producteurs; ils seront alors consommés
par des organismes phytophages ou herbivores, encore appelés
consommateurs primaires. Ces derniers vont être à leur tour l'objet
d'une prédation par des organismes dit consommateurs secondaires,...
Ainsi les algues microscopiques benthiques et planctoniques mais
également la matière organique en cours de décomposition
constitueront-elles les deux principales sources de nourriture des
invertébrés aquatiques qui entreront eux-mêmes largement dans le
régime alimentaire de la plupart des poissons.
En général, pour un écosystème donné le
nombre de niveaux est limité (4 à 5).
Un même organisme au cours de son
développement peut changer de régime alimentaire et passer d'un
stade consommateur C1 à C2 ou C3.
Les déchets produits par ces
organismes, ainsi que leurs cadavres seront transformés par des
organismes (bactéries et champignons) qui dégraderont la matière
organique (ce qui entraîne une consommation d'oxygène) et
restitueront au milieu des éléments simples minéralisés susceptibles
d'être réutilisés par les végétaux chlorophylliens.
Ainsi l'existence de relations
alimentaires étroites entre les organismes aquatiques fait que toute
altération de l'édifice trophique se traduira par une réduction de
la capacité de l'écosystème aquatique à produire, à nourrir et à
transformer.
L'ensemble de ces relations complexes
peut être résumé sur le schéma suivant :
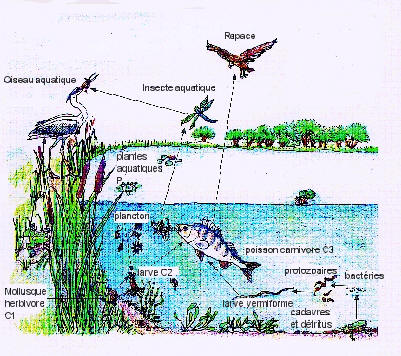
P : producteur C :
consommateur (C1, C2, C3)
Chaîne alimentaire de l'étang. Les
plantes chlorophylliennes utilisant l'énergie solaire sont le point
de départ des chaînes alimentaires terrestres et aquatiques qui,
toutes, sont fermées par l'action des bactéries qui minéralisent
excréments et cadavres.
________________________________________________________________________________
(1) planctonique : se dit des organismes vivant en pleine eau, mais
sans autonomie de déplacement
(2) périphytique : qui vit sur les supports végétaux
(3) benthique : qui vit sur le fond ou dans le sédiment
HAUT DE
PAGE
RETOUR