Les procédés physico-chimiques
constituent de plus en plus rarement en tant que tels une filière de
traitement complète. Ils sont en effet, presque toujours associés à
des traitements biologiques dont ils constituent :
- Soit, un traitement primaire de décantation poussée
- Soit, un maillon ajouté au traitement secondaire
biologique pour améliorer la décantation des flocs bactériens et
conjointement assurer une partie importante de la rétention des
orthophosphates.
S'ils ont une action marquée sur la
fraction particulaire et, dans une moindre mesure, sur la fraction
colloïdale, les traitements physico-chimiques sont sans effet sur la
fraction carbonée et les composés azotés dissous (sels ammoniacaux,
notamment).
______________________________________________________________________
(1) Coagulant = produit qui transforme les charges électriques à la
périphérie des particules leur permettant ainsi de se rassembler
plutôt que de se repousser mutuellement.
(2) Floculant = substance dense, d'aspect souvent gélatineux qui
favorise le regroupement de particules en amas de particules,
appelés "flocs".
2.3 - Traitements secondaires
biologiques
Afin de ne pas alourdir ce chapitre,
nous détaillerons uniquement les procédés biologiques aérobies (en
présence d'oxygène) pour lesquels l'activité épuratoire s'appuie sur
le développement de certaines bactéries (normalement présentes dans
le sol, l'eau et l'air) qui se nourrissent de matière organique. La
pollution est donc transformée en corps bactériens et réserves
alimentaires qui s'agglomèrent en particules appelées flocs. Des
organismes plus évolués (protozoaires) figurent aussi dans les
premiers maillons de cette chaîne alimentaire sommaire, leur action
est importante pour améliorer la qualité de l'eau interstitielle
dans laquelle baigne le floc dont ils facilitent la décantation.
Le développement de cette biomasse peut
s'effectuer de différentes façons :
- en suspension dans l'eau à traiter, on parle alors de
cultures libres;
- sur supports, il s'agit alors de cultures fixées.
Selon la taille du support, on distingue les cultures fixées sur
supports grossiers (la gamme de taille est de l'ordre du centimètre)
et les cultures fixées sur supports fins (dont la taille est
comprise entre quelques millimètres pour les graviers et sables et
quelques dizaines de microns pour les sols).
Nous ne nous intéresserons pas au
filières de traitement biologiques anaérobies (sans oxygène) de
traitement des eaux (dans les digesteurs spécialement aménagés) qui
sont certes efficaces, mais sur des eaux usées très concentrées
uniquement. Elles ne permettent pas d'atteindre un niveau de qualité
compatible avec un rejet direct vers le milieu naturel. Elles sont,
ce de fait, essentiellement utilisées en traitement préalable aux
filières biologiques aérobies dans des industries agro-alimentaires
de grosse taille (distilleries, notamment).
2.3.1 - Cultures libres
2.3.1.1. - Boues activées en aération
prolongée.
Les boues activées constituent la
référence des traitements biologiques aérobies en cultures libres.
L'aération est assurée mécaniquement, soit par des aérateurs de
surface, soit par insufflation d'air. La culture bactérienne est
séparée de l'eau traitée par décantation dans le clarificateur, puis
réintroduite dans les bassins de traitement (c'est-à-dire dans le
cas le plus simple, le bassin d'aération) grâce à la recirculation
des boues.
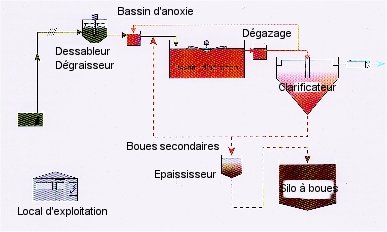
Il existe différents types de stations
à boues activées classés selon plusieurs critères faisant intervenir
la charge à traiter :
- soit par rapport à la concentration moyenne de
culture bactérienne présente dans le bassin d'aération, on l'appelle
charge massique et elle s'exprime en kg de DBO/kg de MVS (3)/jour;
- soit par m3 de bassin d'aération, on parle alors de
charge volumique (kg de DBO/m3/j)
On parle ainsi de boues activées "à
forte charge" ou "à moyenne charge" qui sont de moins en moins
utilisées en raison de leurs performances modestes.
Le type plus connu et, aujourd'hui le
plus largement recommandé, est celui où les ratios de charge sont
les plus faibles (charge massique de 0,1 kg de DBO/kg de MVS/j et
charge volumique < ou = à 0,35 kg de DBO/m3/j), appelé boues
activées en aération prolongée.
La boue activée en aération prolongée
est un procédé capable d'assurer une excellente qualité d'effluents
épurés :
- faible quantité de matière organique résiduelle ainsi
que des abattements significatifs en azote par nitrification et
dénitrification grâce à l'optimisation des réglages d'aération.
L'adjonction d'un bassin d'anoxie jour un rôle sécuritaire;
- abattements en phosphore possibles par
déphosphatation biologique si installation d'équipement spécifiques
(bassin anaérobie en tête, notamment) ou par déphosphatation
physico-chimique par ajout de coagulant dans le bassin d'aération.
Performances attendues (4) :
DBO5 < 25mg/l, DCO < 125mg/l, MES < 25mg/l, NK
< 10 mg/l, NGL (5) > 80 % d'élimination.
Un bon niveau et la pérennité des performances exigent une
exploitation soutenue, par un personnel ayant des compétences en
biologie et en électromécanique.
2.3.1.2. - Lagunage aéré
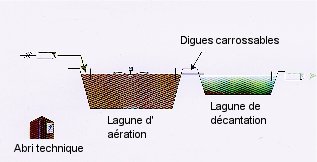
Le lagunage aéré se différencie des
boues activées par l'absence de recirculation de la culture
bactérienne séparée par décantation dans une ou deux lagunes à
l'aval de la lagune d'aération.
Dans cette dernière, la croissance de
la population bactérienne est donc en équilibre avec la
disponibilité, restreinte, de matière organique.
Deux conséquences :
- faible densité de bactéries entraînant un temps de
traitement long dans la lagune d'aération (temps de séjour de 20
jours) pour dégrader la majeure partie de la matière organique
dissoute. On est donc ici en présence d'un système peu intensif, aux
performances limitées mais néanmoins au fonctionnement très stable
qui lui permet de s'adapter à des types d'effluents variés, plus
concentrés comme peuvent l'être des eaux usées domestiques
mélangées, par exemple, avec des eaux d'une industrie
agro-alimentaire, raccordée au réseau communal;
- bactéries faiblement floculées en sortie de lagune
d'aération, ce qui suppose une séparation lente avec l'eau
interstitielle au sein d'une lagune de décantation (temps de séjour
de 5 jours), beaucoup plus largement dimensionnée que ne l'est un
clarificateur de boues activées. Cette biomasse épuratoire
s'accumule au fond de la la lagune de décantation d'où elle est
évacuée, sous forme de boues, tous les 2 ans environ.
Performances attendues : DBO5
< 35 mg/l, DCO = 135 mg/l, MES < 35mg/l, NK = 30%
d'élimination et NGL = 25% d'élimination.
______________________________________________________________________
(3) Matière volatile en Suspension
(4) En gras sont mentionnées les valeurs limites de la circulaire du
17 février 1997, les autres valeurs en découlent logiquement en
fonction des performances des différentes filières de traitement.
(5) NGL = Azote global, il regroupe toutes les formes de composés
azotés qu'ils soient réduits ou oxydés
2.3.1.3. - Lagunage naturel
L'épuration nécessaire à la respiration
bactérienne est produit uniquement grâce aux mécanismes
photosynthétiques des végétaux microscopiques (algues) en présence
de rayonnements lumineux
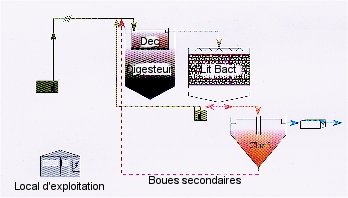
Le dimensionnement s'appuie sur
l'observation du fonctionnement de lagunes installées depuis 15 ans
en France. On recommande une surface de 11 m² par
Equivalent(-Habitant (6) (EH), répartie en trios bassins :
----- La première lagune (6m²/EH) est le siège prépondérant de
l'abattement de la charge polluante carbonée. En sortie de ce
bassin, la concentration en algues microscopiques peut être
importante. Il est éventuellement équipé, en tête, d'une
surprofondeur qui piège une partie des MES apportées par le réseau
d'assainissement et dont la vidange périodique (tous les ans)
facilite le curage des boues qui s'accumulent progressivement sur le
fond de l'ensemble du bassin;
----- La deuxième lagune (2,5 m²/EH) permet un abattement de
l'azote, du phosphore et une réduction de la concentration en
algues;
----- La troisième lagune (2,5m²/EH) continue l'abattement obtenu
dans la deuxième lagune. Elle permet aussi de conserver une bonne
qualité de traitement lors d'un incident (dysfonctionnement) ou
d'une opération d'entretien (curage) survenant sur le premier
bassin.
Les rendements sont en partie sous la
dépendance des saisons (plus faibles en hiver), notamment ceux
concernant les nutriments (azote et phosphore) que les algues
consomment pour leur croissance.
On rencontre cependant fréquemment des
lagunages naturels ne comportant que deux bassins qui ont ainsi été
réalisés au regard de contraintes d'espace disponible ou de
réduction des coûts d'investissement. Les performances sont souvent
moindre, en dépit d'une surface utile du 2ème bassin qui doit au
moins être égale à 5 m²/EH.
Performances attendues : DCO
> 60 % d'élimination, MES < 150 mg/l, NK
> 60
% d'élimination, NGL = 60 % et PT = 60 % d'élimination
______________________________________________________________________
(6) Equivalent-Habitant : Par définition, c'est la quantité de
pollution engendrée quotidiennement par un habitant. mais
conjointement, c'est une tentative de transcription de divers
paramètres caractérisant la pollution en un seul qui peut avoir
différentes valeurs, selon qu'on le regarde d'un point de vue
réglementaire ou d'une représentation plus ou moins fidèle de la
quantité de pollution engendrée dans des contextes différents
(par exemple : milieu urbain ou rural ou industriel)
2.3.2 - Cultures fixées
2.3.2.1 - Sur supports grossiers
En France, les filières de traitement
de type lit bactérien et disques biologiques sont relativement peu
développés (voir tableau 2 sur la répartition des procédés). Ces
procédés font donc l'objet d'un moindre effort de recherche de la
part des constructeurs nationaux qui importent souvent une partie
des équipements. De ce fait, la plupart des innovations ainsi que
les principaux critères de conception sont établis à partir de
recommandations provenant d'autres pays européens.
La biomasse épuratoire est fixée sur un
support sur lequel l'eau à épurer ruisselle. Les larges interstices
de ce support dit 'grossier" permettent une ventilation nécessaire
au bon fonctionnement.
2.3.2.1.1. - Lit bactérien
Le lit bactérien est l'ancêtre des
procédés d'épuration apparu en Grande Bretagne, il y a plus d'un
siècle.

Depuis le milieu des années 1970,
l'utilisation de garnissages "plastiques", ayant des surfaces
développées de 150 à 200 m² par m3 et des indices de vide plus
importants (95 %) que ceux des matériaux traditionnels (pouzzolane,
cailloux, qui ne dépassent pas 50%), permet d'accepter de fortes
charges organiques avec peu de risque de colmatage.
Des progrès ont été réalisés pour
contrôler la croissance du biofilm (ou biomasse épuratoire fixée sur
le support), grâce à une augmentation de la charge hydraulique en
mettant en place des procédures de recyclage en tête de station ou
de lit d'une partie des flux traités. Une plus grande maîtrise de
l'arrosage est aussi obtenue par l'utilisation de sprinklers
motorisés (réduisant la vitesse de rotation des bras d'arrosage qui
se situe aux environs de 6 tours/minute sur les distributeurs
entraînés par simple réaction à l'écoulement)
Les performances sont liées à la charge
volumique traitée, on citera ci-dessous celles obtenues pour une
charge journalière limitée à 0,7 kg de DBO/m3 de matériau. Une
charge volumique plus faible et, par conséquent, un volume de lit
bactérien plus important, les améliorerait mais ne serait pas
compétitif en terme de coût d'investissement par comparaison avec
une boue activée.
Performances attendues : DBO5
< 35 mg/l, DCO = 125 mg/l, MES < 30 mg/l, NK =
50%, NGL = 40 et PT = 30 % d'élimination.
2.3.2.1.2. - Disques biologiques
Les disques biologiques ont connu un
fort abandon depuis 1975 en France, justifié par de nombreuses
défaillances mécaniques et un sous dimensionnement chronique.
D'autres pays européens, en Allemagne
et au Royaume Uni notamment, cette technique figure toujours en
bonne place parmi celles réputées adaptées au traitement des eaux
usées domestiques.
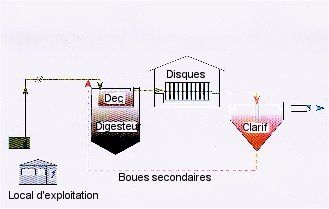
Par conséquent, les constructeurs
présents dans ces pays ont normalement fait évoluer la technologie
vers une plus grande robustesse et fiabilité de la partie mécanique,
d'une part, et vers le développement de nouveaux supports, légers et
offrant souvent une surface développée accrue.
Comme pour les lits bactériens la
qualité de l'eau épurée est directement liée à la charge polluante
appliquée par unité de surface mouillée des disques. Nous citerons
ci-après les performances réalisées pour une charge journalière
limitée à 8 ou 9 g de DBO5/m² qui s'inscrit dans un compromis
technico-économique couramment pratiqué.
Performances attendues : DBO5
< 35 mg/l, DCO = 125 mg/l, MES < 30 mg/l, NK = 50%, NGL =
40% et PT = 30% d'élimination.
2.3.2.2. - Sur supports fins
2.3.2.2.1. - Principes généraux de
fonctionnement
Globalement, il s'agit de systèmes
biologiques de traitement des eaux usées pour lesquels la culture
bactérienne épuratrice se développe sur des supports minéraux
rapportés ou en place [44], de faible taille (de l'ordre de quelques
millimètres pour les graviers jusqu'à quelques dizaines de microns
pour les sols en place réputés adaptés).
La recherche d'une grande fiabilité de
fonctionnement, d'un niveau de traitement élevé, d'une relative
simplicité de mise en oeuvre et d'exploitation, imposent des
critères de conception et de fonctionnement spécifiques :
----- apport de très faibles charges organiques, pur limiter le
développement de la biomasse par limitation de la nourriture
disponible;
----- - fonctionnement alterné de plusieurs réacteurs en parallèle,
pour que l'aération des interstices du matériau, nécessairement
lente car s'opérant essentiellement par diffusion moléculaire,
permette de rétablir, au moins partiellement, un taux d'oxygène
compatible avec une nouvelle phase d'alimentation.
La mise au repos d'un massif filtrant
accentue également la régulation du développement de la biomasse qui
se trouve ainsi placée dans des conditions de disette extrême. Elle
doit, de ce fait, consommer ses réserves et passer en état de
respiration endogène (7), voire régresser par prédation.
En outre, le fractionnement du réacteur
en plusieurs massifs filtrants facilite, dans une certaine mesure,
la nécessaire répartition de flux limités d'eaux usées (de l'ordre
de 150mm/jour pour les filtres enterrés) sur des surfaces
relativement importantes.
Une distribution uniforme de l'eau usée
ne peut être assurée que si elle est temporairement stockée et
envoyée à fort débit pendant un temps limité. Ce processus s'appelle
l'alimentation par bâchées. Les dispositifs utilisés pour réaliser
l'alimentation par bâchées peuvent être un siphon auto amorçant, un
système d'électrovannes couplé à des détecteurs de niveaux dans le
bassin de stockage, un jeu de pompes ou pour les petites
installations un auget basculant dont le volume ne peut guère
excéder 250 litres.
______________________________________________________________________
(7) Respiration endogène = Consommation minimale d'oxygène par la
biomasse lorsqu'elle n'assimile plus de matière organique.
Les critères de dimensionnement sont
établis en fonction de type de matériau support de la biomasse et de
la visibilité ou non du système de distribution de l'eau usée [44].
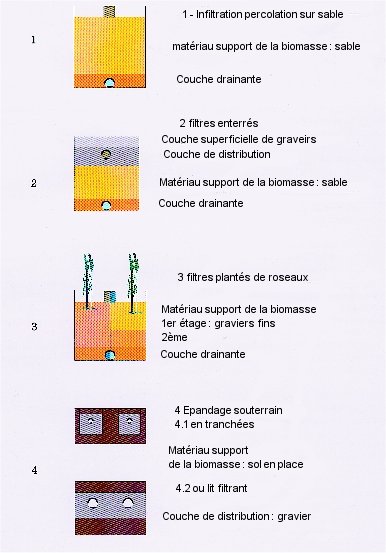
2.3.2.2.2. - Les différentes filières
et leur créneau d'utilisation privilégié
Les lits d'infiltration-percolation sur
sable et les filtres plantés de roseaux sont utilisés en
assainissement collectif pour des communes dont la population
raccordée au réseau d'assainissement varie approximativement de 100
à 1 000 EH. Les filtres enterrés et l'épandage souterrain
s'adressent à des collectivités plus petites de quelques dizaines
jusqu'environ 200 habitants. Ils constituent aussi une part
importante du parc des installations d'assainissement non collectif
où le traitement primaire est alors réalisé par une fosse toutes
eaux. L'épandage superficiel non représenté sur les schémas
ci-joints peut aussi se classer parmi les filières de type "cultures
fixées sur supports fins". S'il présente une perméabilité
convenable, le sol en place constitue alors le support des
micro-organismes et le soeur du système (voir épandage souterrain).
Dans les autres techniques, le matériau
support est rapporté et il s'agit essentiellement de sable, à
l'exception du 1er étage des filtres plantés de roseaux, alimenté
avec des eaux usées brutes, constitué de graviers fins.
2.3.2.2.3. - Mode de rejet
Selon que le rejet s'effectue dans le
réseau hydrographique superficiel ou est dispersé dans les couches
profondes du sol, la mise en oeuvre des procédés est bien sûr
différente au niveau de la base des massifs filtrants qui représente
la couche draînante. Elle est soit munie de drains collecteurs, soit
constituée d'une couche de graviers grossier d'interfaçage ou de
transition avec le sol en place.
Performances attendues : DBO5
< 25 mg/l, DCO < 125 mg/l, MES < 25 MG/l,
NK < 10 mg/l, concentrations élevées de nitrates et donc rendements
sur l'azote global généralement inférieurs à 50% d'élimination.
Les abattement de phosphore sont
faibles avec du sable (qui a un faible pouvoir de rétention,
rapidement saturé). Lorsque le support de la biomasse et,
corrélativement, le milieu de dispersion des effluents traités est
un sol en place (comme c'est le cas pour l'épandage souterrain, par
exemple), les rendements en phosphore sont nettement plus
conséquents et durables car le complexe argilo-humique a un pouvoir
de rétention élevé.
2.3.2.3. - Autres cultures fixées
(biofiltres)
Les biofiltres sont souvent précédés
d'un étage de traitement primaire physico-chimique. Cependant de
nouvelles générations de systèmes apparaissent et seraient capables
de traiter des eaux usées simplement prétraitées; il s'agit de
filières dont la conception évolue rapidement en raison d'un effort
de recherche soutenu.
A la différence de toutes les filières
déjà présentées, les supports, en matériau synthétique (billes de
polystyrène) ou en argile expansée, sont immergés complètement dans
l'eau à traiter. Ils sont donc aérés artificiellement par le fond
via des dispositifs d'insufflation alimentés par des surpresseurs.
Le support de la biomasse constitue aussi un filtre qui piège les
matières en suspension, il n'est donc pas nécessaire de procéder à
une clarification finale des effluents.
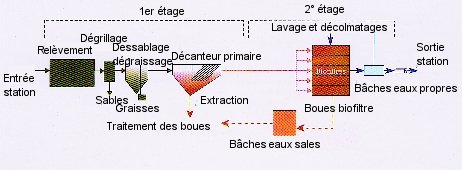
En revanche, des lavages avec de l'air
et de l'eau, injectés à forts débits, doivent être régulièrement
effectués. Plusieurs cellules de traitement fonctionnant en
parallèle et pilotées par des automates plus ou moins sophistiqués
assurent la gestion des diverses phases de traitement. Les eaux de
lavage, chargées de la biomasse en excès arrachée au support, sont
stockées et retraitées. Il s'agit donc de systèmes complexes et
sophistiqués dans les organes de contrôle et commande des divers
organes électro-mécaniques. En revanche, ils sont capables de
traiter des fortes charges sur des espaces réduits mais il s sont
réservés à des collectivités ou des sites industriels dont la
capacité est souvent supérieure à 10 000 EH.
Performances attendues :
Différents systèmes ont été conçus pour s'adapter à des objectifs de
traitement différenciés (traitement de fraction carbonée de la
matière organique ou nitrification et dénitrification). Couplés avec
un traitement primaire physico-chimique, ils peuvent pratiquement
s'adapter à toutes les exigences en matière de rétention de
phosphore au regard des doses de coagulant introduites.
2.4 - Classement des filières de
traitement d'effluents de collectivités au regard de leurs
performances
Le tableau suivant fournit seulement
une indication de la qualité du rejet qui peut être attendue en
sortie de chacun des dispositifs décrits précédemment au regard de
"concentrations types" représentatives d'une eau usée domestique
"normale" (c'est-à-dire basée sur la charge polluante supposée
rejetée par un équivalent-habitant dans un volume journalier de 150
litres).
Cette construction est assez théorique
sachant que :
----- la charge polluante rejetée par un habitant est généralement
plus élevée en ville (notamment les plus grandes) en raison de la
collecte d'une part variable d'eaux de ruissellement de chaussées
lors d'épisodes pluvieux qui provoquent des pointes considérables de
débit et de charge, notamment au début des épisodes pluvieux;
----- pour des réseaux très séparatifs et compte tenu du
renchérissement du prix de l'eau potable, le volume collecté peut
être sensiblement inférieur à 150 litres/EH/jour (90 à 120 litres);
----- pour des réseaux drainants, les volumes peuvent être très
supérieurs à 150 l/EH et par conséquent les concentrations bien
moindres car diluées par des eaux claires.
Tableau 1 : Performances attendues en
sortie des filières décrites précédemment (en mg/l ou %
d'élimination)