Les lieux de prélèvement sont choisis
en fonction de la localisation du flot polluant, de l'étendue de la
pollution à partir du constat de terrain (mortalité piscicole,
effets sur la faune et la flore, aspect et odeur du cours d'eau) et
des tests préliminaires.
Les techniques de prélèvement manuel
pourront être différentes selon le type de rejet.
Le matériel le plus simple pour
prélever des échantillons d'eau est le flacon à large col.
Pour tenir compte des contraintes de
site, le prélèvement d'eau peut être réalisé au moyen d'un seau et
d'une corde (à partir d'un pont par exemple). Dans ce cas, l'agent
préleveur évitera de remettre en suspension les dépôts (ne pas
mettre en contact le seau et les sédiments).
Dans le cas d'eaux stratifiées (effet
de la température, densités différentes rejet-milieu récepteur) et
dans le but de pouvoir prélever dans la masse d'eau polluée, la
technique de prélèvement nécessite un dispositif particulier
constitué d'un cylindre ouvert aux 2 extrémités. A la profondeur
voulue, le cylindre est fermé aux 2 extrémités avant d'être remonté.
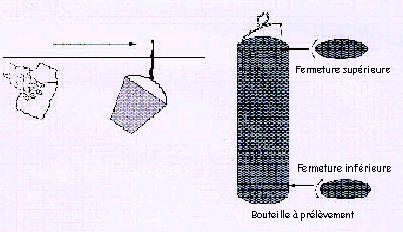
1.1 - Cas général
Les prélèvements seront effectués :
1°) Dans la rivière, en amont du rejet,
en un point non influencé par ce dernier. Dans le cas d'un cours
d'eau, ce point peut être fixé à 50 m environ du point de
déversement. Le prélèvement en amont du rejet permettra de comparer
la qualité des eaux entre l'amont du déversement suspecté et l'aval.
2°) En un point dans la zone des
nuisances où se produit le mélange. Pour un cours d'eau, ce point
est situé à l'aval immédiat du déversement, le prélèvement é"tant
effectué dans une veine d'eau contaminée par l'effluent.
Dans le but de faciliter les recherches
des polluants par le laboratoire et de guider l'interprétation des
résultats obtenus dans la zone de mélange, il sera indispensable de
disposer d'un prélèvement de l'effluent pur avant mélange.
3°) Dans la rivière, à l'aval du point
de déversement, dès qu'est réalisé le mélange de l'effluent et de
l'eau de la rivière, c'est-à-dire à une distance comprise le plus
souvent entre 3 m et 50 m du point de déversement.
4°) Dans la rivière, encore plus en
aval, en autant de points qu'il apparaîtra nécessaire.
Les prélèvements pourront être
effectués dans le courant ou hors du courant, là où une moindre
vitesse d'écoulement peut laisser subsister les traces d'une
pollution résiduelle. Une attention toute particulière devra être
portée dans le cas d'eaux susceptibles d'être stratifiées.
1.2 - Cas de rejets de station
d'épuration
La procédure selon le cas général reste
inchangée.
Toutefois, pour essayer de reconnaître
un mauvais fonctionnement de station d'épuration :
- il est souhaitable de disposer d'un échantillon "moyen" de
l'effluent pur avant mélange, sur une durée de 2 heures minimum
(intervalle de prélèvement : 1/2 heure)
- il est utile d'observer les abords immédiats du point de rejet
dans le cours d'eau. En cas de présence, en surface, de flottants
(mousses épaisses de couleur marron), ou au fond, de dépôts
floconneux brun-marron, des échantillons de ces flottants et dépôts
floconneux pourront être effectués pour un examen microscopique au
laboratoire.
Les prélèvements seront effectués de
préférence en charge maximale.
1.3 - Cas de rejet
partiellement ou non miscibles
a) substances
flottantes (mousses, écumes,
graisses, hydrocarbures)
On se rappellera que ce sont de simples prélèvements
d'identification. La méthode préconisée sera l'écumage.
Lorsque la pollution des eaux visées à
l'article L.232-2 du Code Rural est due à des hydrocarbures
nettement déterminés, il n'est pas nécessaire de procéder à des
prélèvements pour analyse (cf. instruction du M.A.T.E. du
02/08/1996)
b) Substances denses
Pour certaines pollutions, il peut être utile d'effectuer des
prélèvements d'eaux au voisinage du fond (effluents de densité
élevée) ainsi que des prélèvements de sédiments (voir prélèvement de
sédiments)
1.4 - Prélèvements
pour analyses spécifiques
- Prélèvement pour l'analyse des
composés organo halogénés volatils
Les composés organo halogénés volatils sont des solvants chlorés
ou bromés tels que tétrachlorure de carbone, chloroforme,
chlorométhanes, chloroéthanes, chloroéthylènes, chlorobromoéthane.
Ils sont largement utilisés dans des produits d'usage courant. Leur
présence dans le milieu aquatique est due notamment à des rejets
d'industries chimiques.
Ce type de prélèvement est à réaliser
dans des flacons spéciaux équipés de bouchons pénicilline fournis
par le laboratoire d'analyses.
Selon les recommandations de la norme
AFNOR T 90.125 [8], prélever au moins 2 échantillons par point. Au
moment du prélèvement, rincer le flacon avec l'eau à analyser. Ne
pas remplir le flacon complètement (environ au 2/3). Boucher le
flacon et sertir la capsule métallique avec une pince spéciale.

Flacon
Bouchon caoutchouc Capsule
métallique Pince à
sertir
- Prélèvement pour l'analyse des
cyanures
En cas de présence de cyanures (test positif, cf chapitre 4),
l'échantillon est prélevé dans un flacon de 100 ml dans lequel sont
introduites 2 pastilles de soude.
- Prélèvement pour l'analyse du
chlore
En cas de présence de chlore (test positif, cf. chapitre 4),
l'échantillon est prélevé dans un flacon de 100 ml dans lequel sont
introduits 2 ml d'iodure de potassium à 500 g/l.
1.5 - Remarque générales sur les
prélèvements
- Lors du prélèvement éviter de
remettre en suspension des dépôts ou d'introduire du sédiment.
- S'assurer de la propreté du flacon destiné à recevoir
l'échantillon. Le rincer plusieurs fois au préalable avec l'eau à
analyser.
- Vérifier que l'échantillon prélevé pour l'analyse est
représentatif des caractéristiques de la pollution du milieu
(aspect, odeur, validité si nécessaire par les tests).